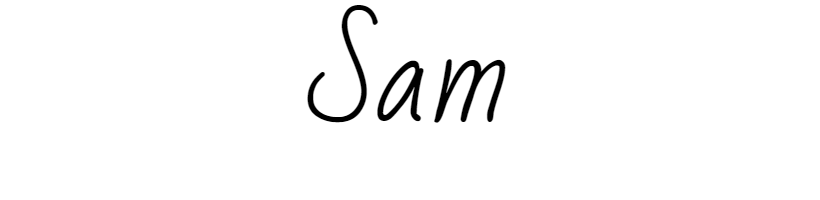Vol N° 11, 27 Juin 2024 :
En cette fin de printemps, un agriculteur est paisiblement en train de faucher son près en bordure du plateau du Larzac. En temps normal, rien ne vient perturber la tranquillité de son travail, même pas les rares automobiles qui passent sur la petite départementale voisine. Mais cette fois, alors qu'il s'apprête à faire demi-tour, une chose dans le ciel attire son attention. C'est un avion, et il a l'air en difficulté. Le petit appareil vole bas, pas plus de 150 mètres. On dirait qu'il vire pour se poser dans le grand champ voisin, où l'herbe est rase. Le voilà qui sort ses volets. Il se présente face au vent, à moins de 100 mètres du sol, moteur réduit. "On dirait vraiment qu'il va atterrir !", se dit-il à voix haute. Soudain, le vrombissement de l'hélice se fait entendre. Le nez de l'avion n'est plus pointé vers le sol, mais vers le ciel. Il repart, plein gaz, vers les nuages. Une minute après, il disparaît dans le ciel. L'agriculteur peut retourner à ses fourrages. "Sacrés aviateurs, ils ne manquent jamais une occasion de faire les malins !"
Cette scène peut faire sourire, mais il est probable qu'elle se répète chaque année, dans tous les coins de France, et au-delà. Cet avion, c'est le Novembre Delta, celui de mon club. Mon instructeur (Michel) ne m'enseigne pas à "faire le malin", bien au contraire. S'il m'apprend à voler au ras des pâquerettes en simulant des atterrissages en campagne, c'est pour me sauver la vie. Maintenant que j'ai réalisé mon vol solo, je suis presque mûr pour réaliser mes premières navigations. Aujourd'hui, le but est de travailler les "Atterrissages de Précaution", ce qu'on appelait autrefois une "Interruption Volontaire de Vol (IVV)". Quésako ?
Imaginez que vous êtes en vol de navigation entre un point A et un point B, en rase campagne. L'aérodrome le plus proche est situé à 30 minutes de vol, mais vous pensez que vous n'y arriverez pas. Plusieurs raisons sont possibles :
- Vous avez oublié de vérifier l'heure du coucher du soleil sur votre terrain d'arrivée, et il va bientôt faire nuit. Vous n'avez pas l'avion ni la qualification pour vous poser de nuit.
- La météo se dégrade fortement.
- Vous avez mal calculé votre bilan carburant, ou vous avez été fortement ralenti par un vent plus fort que prévu. Vous n'avez plus assez d'essence.
- Votre avion a subit une panne importante, vous suspectez que le moteur ne va pas tenir bien longtemps.
- Vous êtes arrivé sur l'aérodrome de destination, mais à cause d'un accident la piste est inutilisable. Le terrain le plus proche est trop éloigné.
Si vous ne pouvez plus vous dérouter vers une autre destination, alors dans ce cas la seule solution est l'Atterrissage de Précaution ! Mais ça consiste en quoi exactement ?
Pour cet exercice, on part du principe que le moteur fonctionne encore, mais qu'il faut se poser rapidement : 10 minutes maxi ! Il faut donc trouver un champ adapté pour s'y poser et se mettre en sécurité. Comme la manœuvre reste dangereuse, la première étape consiste à avertir les autorités et leur donner notre position. En vol, on a plusieurs moyens de le faire :
- Avec la radio, si on est déjà en contact avec un service d'information de vol par exemple, il suffit de passer un message du type : "Mayday Mayday Mayday, F-GNND, j'effectue un atterrissage de précaution près de [là où se trouve]".
On peut aussi passer ce message sur la fréquence internationale de détresse qui est 121.500. - À bord, on dispose d'un transpondeur. C'est cet appareil qui permet d'afficher la position, l'altitude, la vitesse et l'immatriculation de notre avion sur les écrans radars des contrôleurs aériens. Ces derniers peuvent nous demander d'afficher différentes combinaisons de codes à 4 chiffres sur le transpondeur, pour nous identifier. En cas de détresse, on affiche le code 7700, et les contrôleurs sont immédiatement avertis de notre situation.
- La plupart des avions de club sont également équipés d'une balise de détresse, qui s'active automatiquement en cas de choc. On peut la basculer en mode "manuel" pour avertir au plus tôt les secours de notre position, avant même de se poser.
Ensuite, on recherche le champ "idéal". On a quelques minutes seulement pour en trouver un. Puis on effectue une première reconnaissance haute juste au dessus, à environ 1 000 ft du sol, pour s'assurer qu'il soit vraiment adapté. Pour ça, on utilise un acronyme pour nous aider :
VERDO
V : VENT. Comme sur un aérodrome, on privilégie toujours de se poser face au vent. Cela permet notamment de réduire notre vitesse par rapport au sol. Ainsi la distance nécessaire à l'atterrissage est plus courte, et on diminue aussi les risques en cas d'atterrissage raté. Il faut alors se rappeler de la direction et de la force du vent étudiée lors de la préparation du vol, et trouver un champ qui soit à peu près dans cet axe. En l'absence de manche à air, on peut s'aider de fumées, ou de nuages de poussière pour repérer le vent.
E : ÉTAT DU SOL. Pour éviter un freinage trop brusque, qui risquerait de nous faire basculer sur le nez, on privilégie une surface plus dure, où la végétation est rase. Il faut ainsi privilégier dans l’ordre :
a) Les chaumes
b) Les terrains labourés hersés
c) Les cultures fourragères
d) Les cultures céréalières
e) Les terrains labourés non hersés
f) Les cultures hautes
R : RELIEF. On inspecte la topographie du terrain : on évite les collines et les terrains accidenté. Si le terrain est en pente, on se pose de préférence face à la montée, même avec du vent arrière, plutôt que dans le sens de la descente, pour réduire la distance nécessaire au freinage.
D : DISTANCE. On s'assure que le champ est suffisamment long pour nous éviter de finir dans la haie à son extrémité ! Pour le mesurer, on se présente face au vent, à 150 km/h et on déclenche le chrono au début du champ. On sait alors qu'à chaque seconde, on parcourt 40 mètres. Il nous faut donc 14s environ pour obtenir une distance de sécurité suffisante pour notre appareil.
O : OBSTACLE. On évite les champs avec des obstacles proches du type lignes électriques, habitations, fossés, abreuvoirs pour le bétail, etc.
Une fois qu'on a vérifié tout à ça, on effectue une deuxième reconnaissance à basse hauteur, environ 500 ft du sol pour s'assurer qu'on peut se poser en sécurité. Si tout est bon, alors on peut reprendre un peu d'altitude et exécuter un circuit de piste rapproché, sans perdre le champ de vue, afin de préparer l'appareil à l'atterrissage. Ensuite, on procède comme d'habitude, en s'efforçant de garder la vitesse d'approche la plus faible possible, sans pour autant se mettre en danger. En finale on sort deux crans de volet, et en situation réelle on se prépare à un atterrissage de précision. Évidemment, on ne va jamais jusqu'au bout de l'exercice ! L'instructeur nous demande de remettre les gaz, au plus tard à 50 m du sol.
Pour cette première expérience de l'Atterrissage de Précaution, je trouve l'exercice vraiment difficile, mais très amusant ! Pas facile de voler à basse altitude, avec une vitesse réduite (150 km/h), en inspectant des champs, tout en restant toujours en sécurité. Il faut faire très attention à sa vitesse, et aux éventuels obstacles (lignes à hautes tensions !), tout en passant la check-list VERDO dans sa tête. Notre regard n'arrête pas de bouger entre les différents instruments et l'extérieur. Pas simple, mais ultra formateur ! En tant que jeune lâché, c'est une bonne chose de sortir du cadre rigide des tours de piste standard. Essayer d'appliquer tout ce qu'on a appris sur un simple champ, dont la forme n'est pas forcément bien longue et rectiligne comme une piste d'atterrissage, c'est un défi passionnant. Et, accessoirement, c'est un des exercices imposé pour l'examen pratique. Il va donc falloir le répéter encore, et encore, jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature.
En rentrant à Millau, Michel me demande de faire deux exercices d'encadrement sur le terrain. La manœuvre consiste cette fois à simuler une panne moteur. On se présente à la verticale du terrain, avec les gaz complètement réduits, pour revenir se poser sur la piste en vol plané uniquement. Interdiction de toucher à la manette des gaz ! Grâce aux conseils de mon instructeur, ça se passe plutôt bien. Il faut dire que mon expérience en planeur m'aide bien sur cet exercice, mais là aussi, il va encore falloir s'entrainer longtemps pour arriver à un niveau de maîtrise suffisant. Non seulement l'exercice d'encadrement peut sauver la vie, mais il est lui aussi imposé lors de l'examen pratique. Je détaillerai la prise de terrain par encadrement plus tard, dans un prochain article. Maintenant, place à la navigation !
Vol N°
Temps de Vol
Solo
Total
Heures de Vol
Atterrissages